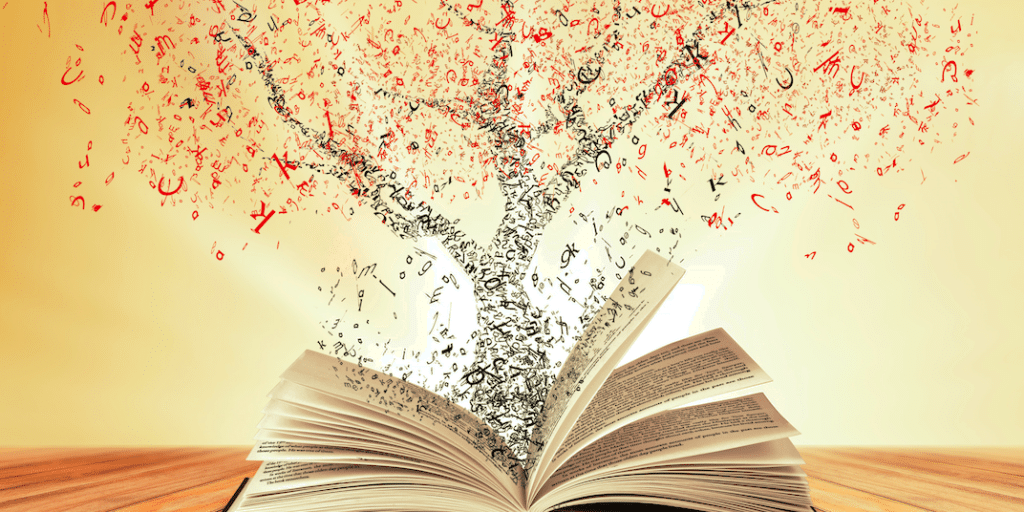Nous avons tous vécu durant notre adolescence des moments heureux et malheureux, ressenti des émotions d'une intensité à nulle autre pareille, mais aussi connu le vertige existentiel et l'ennui mortel. Bon nombre d'entre nous ne s'en souviennent pas, d'autres en gardent un souvenir partiel et doivent faire un effort parfois pénible pour raviver les quelques images éparpillées de cette époque lointaine et proche à la fois. Pour la majorité d'entre nous, il ne reste que le souvenir d'évènements singuliers associés à des lieux spécifiques (le collège et le lycée) et enfin les amis qu'on a gardés et ceux qu'on a perdus. La qualité du regard que nous portons sur cette période de notre vie dépend de la manière dont nous en sommes sortis. Communiquer, échanger, parler avec les adolescents semble devenir une tâche ardue pour les adultes qui assument une responsabilité pédagogique et/ou éducative. Nous montrerons quels éléments fondamentaux de la psychologie de l'adolescent sont à l'origine de ces difficultés et comment la littérature et les histoires en général sont essentielles à la métamorphose adolescente.
Les enjeux psychiques de l'adolescence
« Non seulement ils veulent tout découvrir mais ils veulent le faire seuls »[1]
La notion d’adolescence met souvent l'accent sur les changements physiques mais les conséquences psychologiques n'en sont pas moindres pour autant : un sentiment d’étrangeté, un trouble de la conscience de soi et de l'identité ; une modification de ses rapports à l’adulte et à l’environnement ; un éprouvé angoissant et une absence de maîtrise sur ce qui advient.
L’adolescent n’a d’abord plus aucune prise sur son image, qui s’impose à lui comme venant de l’extérieur. Son corps devient le siège de sensations nouvelles et d’excitations génitales qu’il lui faut apprivoiser. Les repères de l’enfance sont définitivement perdus et cela peut engendrer des peurs exagérées de déformations du corps. La violence de ces changements contraint l’adolescent à réagir en cherchant à maîtriser les apparences et les formes que prend son corps. Exposé au regard des autres, il se sent fragile, comme si les autres pouvaient lire ce qui se passe en lui. Françoise Dolto parlait à ce sujet du complexe du homard [2], parce que cet animal se cache quand il mue car sa nouvelle carapace est molle et cela le rend vulnérable.
L'adolescent n’a souvent pas les mots pour parler de ce qui le trouble, surtout avec les adultes. Il substitue alors l’acte à la parole, évite les échanges verbaux, se plie de moins en moins aux échanges avec ses parents. Il cherche ainsi à mettre à distance l’enfant qu’il a encore en lui. Cette distance est la condition à l'acceptation de l'altérité, dont dépend sa sociabilité future.
L’adolescence est donc un moment de rupture dans la continuité de l'existence. Si ce vécu de rupture n'est pas pensé, il risque de provoquer un break-down[3], c'est-à-dire une dépression qui s'apparente à une cassure. Dans ce cas, les relations, les émotions partagées pendant la petite enfance et l’enfance sont le meilleur atout pour réparer la cassure. Cette cassure tellement douloureuse que Philippe Gutton affirme qu'il faut accueillir les adolescents dépressifs en psychothérapie comme s'ils étaient des soldats qui reviennent de la guerre... Il distingue subtilement solitude et désolation.
La solitude permet à l’adolescent une prise de distance suffisante à l’endroit de ses parents sans fragiliser pour autant la relation avec eux. Dans la bonne solitude, le contact psychique avec l’autre est gardé. Trop près, les parents sont intrusifs, trop loin ils ne jouent pas assez leur mission. Les parents d'un adolescent doivent être suffisamment présents lorsqu’ils s’absentent et suffisamment absents lorsqu’ils sont présents ! C'est ainsi que la solitude constitue un affect clé du processus d'adolescence. Elle détermine la mise en place progressive de l'autonomie psychique et la possible relation avec les autres, dehors. La solitude est en effet la source de l'altérité.
Mais si la solitude colle au corps et qu'elle englue la pensée, il s'agit alors de la désolation, au sens d'être désolé et isolé. La désolation rend impossible la rencontre avec l'autre. Elle conduit à l'isolement et au vécu abandonnique qui stérilise l'altérité et provoque la cassure. Un des objectifs de la psychothérapie d'adolescent est alors d’augmenter la tolérance à la solitude, c’est-à-dire la capacité d’être seul avec les autres « internes », en pensée.
La littérature, les histoires, les mots, jouent le rôle d'une digue protectrice face au risque de cassure. Parce que nous sommes « des êtres de langage » (Françoise Dolto) et aussi « des animaux qui aimons les histoires » (Aidan Chambers), la littérature est essentielle à l'épanouissement de la pensée adolescente toute neuve. Les histoires réaniment le paysage de la désolation en le peuplant de figures héroïques. La lecture de fictions romanesques répare les trous d'une enveloppe psychique abimée mais ne guérit pas l'adolescent d'une destruction déjà installée... Ne nous leurrons pas, la lecture n'est pas un soin. Elle nourrit seulement ceux dont les outils psychiques sont efficients. Il existe des béances psychiques qu'aucun livre, si bon soit-il, ne saura combler.
L'adolecteur au travail...
« La seule chose qui compte, c'est que tous, d'une manière ou d'une autre, nous parvenons à échapper à notre histoire. »[4]
La littérature donne à la solitude ses lettres de noblesse car elle peuple le vide de personnages qui, même s'ils sont imaginaires, provoquent des rencontres authentiques. Les adolescents lecteurs cherchent à rencontrer en littérature et ailleurs les sensations et les émotions qui constituent son tout nouveau Moi. Comme l'écrivait J.D. Salinger, « Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super-copain et on lui téléphonerait chaque fois qu'on aurait envie. Mais ça n'arrive pas souvent. J'aimerais assez téléphoner à Karen Blixen. »[5]
Le « Projet Adolecteur » est une recherche psychologique menée sur le terrain afin d'étudier les modalités psychiques de la relation de l'adolescent lecteur avec la fiction réaliste et ses personnages. Les rencontres se sont déroulées au sein du Lycée Henri Avril[6] de Lamballe grâce à la médiation d'Isabelle Guilloteau, professeure de français, et d'Alain Le Flohic, bibliothécaire scolaire, tous deux passionnés de littérature et acteurs enthousiastes de leur mission éducative. Avec leur concours, j'ai établi un contact de qualité avec les adolescents et bénéficié de la confiance qu'ils accordaient à leur professeur et au passeur de livres ! Cinq romans[7] ont été mis à disposition des adolescents dans la bibliothèque du lycée. Isabelle m'a fait cadeau d'une heure d'enseignement dite « banalisée » du vendredi matin pour nos rencontres collectives. Habituellement, on peut considérer qu'elle travaille avec ses élèves d'une manière peu banale, en leur proposant, par exemple, « un livre pour le week-end ». J'ai également réalisé un ou deux entretiens individuels avec chaque adolescent volontaire participant à la recherche.
Les adolescents se sont engagés à lire les cinq romans proposés, ou du moins, tenter de les lire. Les romans ont été mis à leur disposition au centre de documentation du lycée dès le mois de novembre et nos rencontres collectives ont commencé fin janvier. Au mois de mars et avril je me suis entretenue individuellement avec chaque adolescent volontaire. Ils avaient tous la possibilité de se retirer du dispositif à tout moment de l'évolution de la recherche, de participer aux séances collectives et aux entretiens individuels selon leur gré. Le respect de leur anonymat est garanti à tous les élèves participant à l'étude. Plus d'une vingtaine d'adolescents ont été présents à chaque rencontre et dix-huit d'entre eux ont participé activement aux discussions collectives ; onze ont participé aux entretiens individuels.
Les séances collectives se sont déroulées dans la salle de classe de français. Les débats ont été enthousiastes mais aussi, parfois, conflictuels du fait d'âpres discussions à propos de l'appréciation de chaque roman par chaque adolescent. Il apparaît en première impression que les jeunes lecteurs ont exprimé des sentiments positifs et négatifs à l'égard des personnages des fictions proposées. Les divergences d'opinions concernant certains romans, les critiques, parfois crues, à l'égard du « rythme » littéraire d'une oeuvre, de la dimension humaine d'un personnage montrent une lecture impliquée. L'élément le plus significatif demeure la capacité d'identification au personnage principal. Certains personnages ont profondément dérouté la grande majorité des jeunes lecteurs. La lenteur du récit, le « manque » d'action, et la perturbation mentale ou le handicap du héros constituent les points autour desquels se sont cristallisés les fantasmes de rejet.
Pour que vous compreniez à quel exercice difficile je les ai invités, voici ce qu'en dit Soledad, dans l'après-coup de nos groupes de parole. « Au début j'avais un peu peur, parce que parler des livres, j'aime bien, mais, j'avais un peu peur de pas être d'accord avec les autres, parce que j'suis assez speed, du coup, j'avais peur qu'ils soient pas d'accord… mais je trouve ça super intéressant... On voit ça d'une autre façon, mais j'avais peur aussi de… de plus penser… parce que j'aime bien finir un livre et rester sur ma fin (faim ?) euh... rester sur la dernière chose que je pense et j'avais peur après, d'avoir une autre opinion du livre, de le voir d'un autre œil et que ça serait pas super … » Malgré l'appréhension générale exprimée par Soledad, les adolescents se sont lancés dans l'arène avec enthousiasme, ils ont affuté leur esprit critique et affirmé leurs opinions avec une insolente pertinence... Soledad exprime une crainte liée à la porosité de son Moi tout neuf : elle craint que les autres ne la fasse changer d'opinion...
L'adolecteur attend du héros de la consistance dans ses actes, dans sa pensée, dans ses intentions et dans la manière de réaliser ses désirs. Dès qu'il ne joue pas ce rôle, et même doté des qualités intrinsèques à l'archétype du héros de fiction, il s'établit une distance entre le lecteur et lui. Si la perception du monde se dérobe de la perception du personnage principal, l'histoire s'immobilise et perd sa consistance. Le lecteur encourt le risque d'un vertige existentiel dont il se protège par l'ennui, la lassitude ou bien l'agacement. « Il ne se passe rien », « Ça bouge pas assez », « c'est lent », « c'est mou », « on s'ennuie » sont des représentations de l'inanimé qui font émerger l'idée de la mort. Non pas celle qui surgit, violente, par accident mais celle qui est tapie dans l'ombre, une certaine idée du néant, du vide.
La formule « ça m'énerve » est récurrente dans les propos d'adolescents et elle signifie bien plus que ce qu'elle laisse entendre. Les adolescents s'accommodent mal des ralentissements, de l'immobilité. La lenteur et la routine engendrent l'ennui et la morosité. Le rejet de ces sensations est accompagné d'une certaine impatience. Mais on ne traverse pas lentement une zone de turbulences. Il faut bouger pour explorer les environs et maintenir un état de tension pour se tenir en équilibre sur le bord du monde... L'étude du discours des adolescents lecteurs montre les processus de liaison psychique à l'œuvre : ils associent leurs idées autour d'un drame imaginaire vécu par les personnages de l'histoire, transposent éventuellement dans leur vie la situation fictive et réagissent avec empathie aux heurs et malheurs des personnages, ou bien au contraire, les rejettent sans pitié, les abandonnant à leur sort tragique. Ils éprouvent plus que quiconque des émotions violentes quand le personnage de l'histoire est vulnérable et menacé. Mais ils ne sont pas menacés dans leur intégrité psychique par les événements tragiques de l'histoire.
La morale de l'adolecteur
La pensée est une enveloppe destinée à contenir les émotions liées à la violence d'une histoire. Si la pensée de l'adolescent est encore immature, cela explique une inaptitude absolue à la complaisance, voire au compromis. Dans le discours des adolecteurs apparaît une constante relative à l'exigence de justice, quitte à en passer par la vengeance. Ce trait rejoint la caractéristique adolescente soulignée par Winnicott : « ils n'acceptent pas de fausses solutions » et manifestent une « moralité farouche basée sur le réel »[8]. C'est ce que j'ai observé dans les commentaires des adolecteurs concernant le roman Je mourrai pas gibier de Guillaume Guéraud.
Martial, meurtrier de 14 ans, recueille toute la douloureuse sympathie des jeunes lecteurs car par son geste désespéré, il venge Terence, simple d'esprit victime/gibier de la cruauté sans limites des hommes/prédateurs du village. Dès le début du roman, le lecteur est délivré de tout suspense. Les morts gisent sur le sol dès la première scène du premier acte. L'écriture est incisive, lapidaire ; les mots de Guillaume Guéraud jaillissent par salves comme autant de balles qui fusent et tuent. Le bien et le mal sont dissous dans le non-sens ; la haine sécrétée par les personnages a un effet sidérant. C'est le chaos. Le lecteur n'en émerge qu'identifié à un désir de vengeance. Le sentiment d'impuissance de Martial est exacerbé par son isolement, sa différence. La destruction comme solution à un désespoir total engendre un sentiment profond de tristesse et de désolation.
Pourtant chaque adolecteur se reconnaît dans la violence meurtrière perpétrée par Martial sur sa propre famille. La source de l'inquiétude des adultes concerne le danger d'identification au jeune meurtrier. Ce que nous disent les adolecteurs ne manquera pas de les rassurer. Le sol jonché de cadavres de la scène inaugurale ne réjouit aucun d'entre eux, au contraire, ils sont bouleversés et parfois choqués. En revanche, quelque chose chez Martial les attire irrésistiblement. Ce choix moral paraît dangereux aux yeux des adultes mais, selon Paul Ricoeur[9], il conditionne la construction identitaire de l'adolescent en référence à l'autre. La capacité à se penser « soi-même » en tant qu'autre, se mettre à la place d'autrui engendre l'empathie et non la complicité. L'adolecteur peut se représenter mentalement une situation violente sans souffrir de la violence elle-même. Il montre la capacité, que ne possède pas encore l'enfant, de souffrir en empathie avec l'autre dans la fiction. Il est en « apprentissage » d'altérité et cela lui confère la distance qui le protège du passage à l'acte, véritable déni d'altérité dont souffre Martial, adolescent noyé dans la désolation.
« C'est beau un livre plein de sentiments, de rage et de tristesse... », me confiait Jovica lors d'un entretien. La rage et la tristesse sont au rendez-vous final avec Ève/Marion (Je reviens de mourir). L'héroïne est « un peu morte au fond d'elle-même » depuis le jour où elle a rencontré son bourreau, disent Saël et Barnabé. Il s'agit donc du drame d'un enfant sans avenir. Elena exprime un avis d'autant plus violent qu'il semble, au premier abord, conforter la victime dans son destin tragique. Elle n'avait pas le choix, il valait mieux qu'elle disparaisse de la scène puisque, de toutes façons, battue et misérable, elle n'aurait pas d'enfant. Eve/Marion est un personnage qui a bouleversé les adolectrices. Elle a suscité l'agacement, la colère ou le rejet massif. Ce personnage à la dérive ne lutte plus, il est perdant. La défaite n'est pas envisageable pour les adolescentes qui se sont rebellées contre la fatalité de ce destin tragique. Il y avait peu de place pour la compassion car le combat était leur credo. Là où un lecteur adulte s'apitoie, un adolecteur invite le héros à se battre. Une question d'âge...
Aidan Chambers raconte avec humour comment Macbeth[10], jouée au théâtre, engendre la joie des spectateurs à la fin du dernier acte. « Il y a six cadavres sur la scène, tous tués, y compris Macbeth, tête coupée. Et à la fin de la pièce, les gens sortent du théâtre en disant : « N'était-ce pas merveilleux ? J'ai vraiment adoré ! » Et il demande : « Sommes-nous des animaux pour adorer des spectacles de ce genre ? »[11] Certes non, nous aimons les histoires qui parlent de nous, de notre cruauté fondamentale. Lorsque le seuil pubertaire est franchi, il faut que quelqu'un meure... symboliquement. Un adolescent meurt à son enfance[12] et c'est la raison pour laquelle la violence est inhérente à cette métamorphose. Le déchaînement meurtrier que l'on trouve dans ses fictions préférées doit être sous-tendu par une atmosphère héroïque. S'il faut mourir, il faut que ce soit pour une « bonne » cause, en vertu du sens que la mort donne à la vie. Il faut que la mort d'un personnage sauve quelqu'un ou quelque chose.
Pour conclure...
« Jusqu'à ce que vous ne rencontriez dans des histoires un moi reconnu comme le vôtre dans un groupe de personnes culturellement défini à qui vous estimez que vous appartenez, vous ne croyez pas que vous existez. »[13]
Le plaisir de lire ne peut provenir que de ces rencontres que nous avons faites au moment de la métamorphose cruciale que fut notre adolescence et de la manière dont les livres nous ont permis d'échapper à la désolation.
Lire c'est détenir les clés d'un monde imaginaire où tout peut arriver, le pire et le meilleur, sans qu'aucun dommage ne soit à déplorer.
Etre bibliothécaire, c'est distribuer des tickets aller-retour pour l'aventure.
Annie Rolland